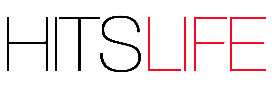Mort de Zoran Music
Mort Zoran Music, ou la peinture à l'épreuve de l'horreur
Déporté à Dachau, le peintre italo-slovène n'a jamais pu oublier ce "paysage de mort" qui a habité toute son œuvre. Il est mort, mercredi 25 mai, à Venise à l'âge de 96 ans. A cette occasion, nous republions l'entretien que l'artiste avait accordé à Philippe Dagen à l'occasion d'une exposition au Grand Palais à Paris. Un article paru dans Le Monde, le 7 avril 1995.
D'un immense appartement, au dernier étage d'un immeuble du boulevard Saint-Germain, Zoran Music a fait son atelier. Il s'excuserait presque d'être si bourgeoisement logé. "Je suis venu ici pour la lumière. L'appartement est très lumineux. Or j'ai des problèmes d'yeux. Il va falloir m'opérer." Contre les murs, des toiles sont retournées. Dans ce qui fut une salle à manger, il a disposé des chevalets et placé la table où il dessine. Partout des têtes, des silhouettes et des autoportraits, à la plume sur des feuilles volantes, au fusain et à l'huile sur des toiles grises.
"Aucun de ces tableaux n'a jamais été fait d'après modèle. Si le modèle était devant moi, il me gênerait. Ce que je veux, c'est découvrir ce qu'il y a en dessous du masque, à l'intérieur. Ce qui compte se situe en dessous de la surface."
Des références s'affirment : "Titien, Rembrandt, Goya : voilà ceux auxquels je pense. Souvenez-vous du dernier autoportrait de Titien. Il l'a peint avec rien, un peu de noir, et il arrive à l'essentiel." Porté par le souvenir, Music évoque sa formation dans l'entre-deux-guerres. "J'étais un très bon élève, mais sans personnalité. J'allais de l'impressionnisme à Bonnard, de Bonnard à Derain. Je regardais aussi du côté de ces peintres que les Français ne veulent pas connaître, les Viennois Schiele, Kokoschka et les Allemands Corinth, Dix, Beckmann. Mais tout cela ne faisait qu'un peintre assez médiocre..." Puis, revenant au Titien : "C'est cela qu'il faudrait atteindre : faire le tableau avec rien, en évitant tout le côté travail. Mais y parvenir... Le peintre vit avec le doute, on l'enterre avec son doute, qui l'a tourmenté et l'a fait travailler toute sa vie... On ne peut juger la peinture qu'après des années."
Le regard va d'une toile à l'autre, d'un fantôme à un autre. Mais ce n'est pas en ces termes que Music en parle.
"Dans mes autoportraits, ce que je peins, c'est un paysage intérieur. Je n'ai peint que cela, des paysages, depuis le début. Quand je suis revenu de Dachau, ce paysage de mort, tout ce que je voyais, c'était des paysages déserts ou à demi désertiques. Ceux de Dalmatie, les collines autour de Sienne, c'était pareil : des paysages qui ne changent pas, la terre à nu, les dessins de l'érosion. Quand j'ai traversé les collines siennoises pour la première fois, j'ai été choqué : j'avais le sentiment d'être revenu dans un paysage familier dans le camp. Le camp ressemblait à un désert, des milliers de cadavres, les os recouverts d'une pellicule de peau blanc argenté."
Philippe Dagen : Vous avez dessiné cette vision abominable.
Zoran Music : Il le fallait. C'était abominable, mais c'était nécessaire. Je ne pouvais pas faire autrement. Dans le camp, il y avait une usine d'armement, avec des bureaux pour architectes. On m'y a mis un moment, j'ai pu prendre du papier, j'ai commencé... C'étaient des dessins descriptifs. Dans ces corps amaigris, les mains, les pieds et les sexes devenaient très importants. Et la structure, les doigts très fins, d'une finesse incroyable. Egon Schiele a dessiné des mains ainsi, mais il me semble que ce sont des dessins trop voulus, trop théâtraux. Schiele a cultivé ce genre, alors que, chez moi, c'était simplement le fait de l'observation.
Ph. D. : Sur certains dessins, vous avez noté les matricules des morts.
Z. M. : Les Allemands étaient précis dans tous les domaines. Il y avait des milliers de corps qu'ils jetaient dans des fosses ou dans les fours crématoires. Mais, à chacun, ils accrochaient à l'orteil un carton où étaient inscrits son nom et son numéro. J'ai dessiné cela aussi, comme une absurdité de plus. J'ai noté des noms aussi, des noms de morts que je ne connaissais pas.
On m'a demandé parfois si j'avais fait ces dessins pour témoigner. Mais comment aurais-je eu la volonté de témoigner alors que j'ignorais si je serais encore vivant le lendemain ? Du reste, après la guerre, quand je suis rentré à Venise, personne ne voulait voir ces dessins. Les gens étaient saturés d'horreur.
Ph. D. : Dans votre œuvre, Dachau n'a resurgi que vingt-cinq ans plus tard.
Z. M. : Resurgi brutalement. Quand je suis revenu à Venise en 1945, j'ai commencé à peindre des paysages et des chevaux. Après ce que j'avais traversé, j'avais besoin de me réfugier dans l'enfance. Je sortais d'un trou noir, il me fallait de la lumière et de l'espace. Puis un long travail intérieur a commencé, ici, à Paris. Quand je suis arrivé, dans les années 50, je me suis trouvé parmi tous ces grands maîtres abstraits... Ils croyaient, et moi avec eux, que l'abstraction était une chose définitive, la seule juste et vraie. Un figuratif, c'était un pauvre type qui ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. Je me sentais coupable, terriblement petit, maladroit. Je ne savais pas comment m'approcher de l'abstraction. J'essayais pourtant, à partir de mes paysages. Mais je savais que là n'était pas ma vérité.
Au demeurant, il y avait de bons peintres parmi eux, Wols par exemple. Mais ceux qui m'intéressaient, c'étaient Bacon et Giacometti... Giacometti, je le rencontrais de temps en temps à Montparnasse. Il ne disait presque rien et je n'étais pas plus bavard. On restait assis l'un en face de l'autre, sans presque se parler. Puis nous repartions ensemble par le boulevard Raspail, sans nous parler beaucoup plus du reste... C'était le plus fort.
L'abstraction, elle, est devenue peu à peu un métier et il n'y a rien de pire que l'art devenu un métier. Tous faisaient la même chose de mieux en mieux. Et moi au milieu d'eux, qui étaient tous très amicaux. J'avais compris que je n'y arriverais jamais de cette manière. Entre 1962 et 1970, je n'ai plus fait que dessiner, sans peindre... je savais que ça devait sortir, je ne savais pas comment. Je ne savais pas dans quelle forme.
Ph. D. : Comment peindre l'extrême de l'horreur ?
Z. M. : J'aurais pu illustrer. Ce n'aurait pas été difficile. Je ne voulais pas. J'attendais que cette vision prenne une forme dans ma mémoire. Elle était en permanence devant moi, ces cadavres allongés. Pour réussir à sortir une lumière de cela, il aurait fallu un Goya peut-être. Il me semble que je n'ai pas réussi comme je l'aurais voulu. Ce n'était pas possible peut-être. Si j'ai réussi à donner à celui qui regarde un peu de mon émotion, c'est déjà beaucoup."