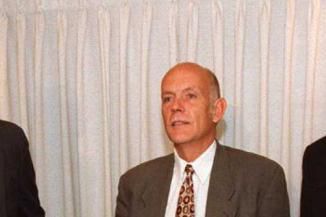Mort de Richard Smalley
Mort Richard Smalley, Prix Nobel de chimie, codécouvreur des fullerènes
Colauréat du prix Nobel de chimie 1996 avec deux autres collègues britannique et américain, Harold Kroto et Robert Curl, Richard Smalley est mort d'un cancer, le 28 octobre, à Houston. Il était âgé de 62 ans.
Brillant esprit, ce physicien américain, né le 6 juin 1943 à Akron (Ohio), a révolutionné avec ces deux chercheurs le monde du carbone dans les années 1980. Il a fait alors découvrir à l'humanité une forme totalement inattendue de cet élément chimique. Un carbone qui n'était ni en couches comme le graphite, ni en édifices cristallins d'une dureté inégalée comme le diamant. Mais un carbone... en tubes et en "ballons de football".
L'histoire commence au début des années 1980. Le chimiste et astrophysicien Harold Kroto vient de braquer les antennes d'un radiotélescope vers le ciel. Il observe sur ses clichés "une raie caractéristique" du carbone. Surprise : elle ne correspond à aucune des formes connues de cette substance.
L'astrophysicien s'interroge mais n'aboutit pas dans sa démarche pour comprendre le phénomène. Et ce jusqu'en 1984 où, lors d'un congrès consacré aux structures moléculaires qui se tient à Austin (Texas), il rencontre Robert Curl qui lui vante les mérites d'un nouvel appareil - un laser pulsé - capable de vaporiser à peu près n'importe quoi et qu'il utilise avec Richard Smalley.
Ancien étudiant en chimie de l'université du Michigan et de l'université de Princeton (New Jersey) où il a obtenu son PhD en 1973, puis enseignant à partir de 1976 à l'université Rice (Texas), Richard Smalley est un chercheur atypique qui a cotoyé l'industrie, notamment celle du pétrole, avant d'embrasser la carrière universitaire. De ce parcours, il a gardé des capacités à penser différemment.
Avec Curl, il travaille sur des agrégats métalliques composés de quelques molécules ou d'un nombre limité d'atomes. Qu'à cela ne tienne, on peut tout aussi bien remplacer ces matériaux par du carbone. Les trois chercheurs vaporisent alors leurs échantillons et observent une "raie" étrange paraissant provenir d'une molécule comportant soixante atomes de carbone !
DÉVELOPPEMENT FULGURANT
Mais quelle forme peut-elle avoir ? Des collègues mathématiciens avancent qu'une telle structure doit être comme un ballon de football. Une sorte de boule à facettes composée de 20 hexagones et de 12 pentagones... Par référence à l'architecte américain Buckminster Fuller, concepteur dans les années 1950 de dômes géodésiques, les trois scientifiques baptisent leur nouvelle découverte "Buckminsterfullerène", renommée ensuite C60 par les scientifiques en référence au nombre de ses atomes de carbone.
Richard Smalley et ses deux collègues ont eu beaucoup de chance. D'autres travaillaient en effet sur ce thème, ce que les trois futurs Nobel ne savaient pas. Mais qu'importe. Ils ont eu le mérite de produire les premières molécules de C60 que l'Allemand W. Krätschmer parviendra à fabriquer en quantité en juillet 1990.
Très vite, les chercheurs du monde entier se sont emparés de cette découverte et ont fabriqué en laboratoire toutes sortes de fullerènes. Des boules, des ballons et même des tubes minuscules, les nanotubes, aux propriétés physico-chimiques suffisamment dignes d'intérêt pour que l'on prédise à ces matériaux un développement fulgurant dans la supraconductivité, l'informatique, les câbles ou les réservoirs d'hydrogène...
La vérité a été tout autre et, comme souvent en science, les choses ont avancé lentement. Mais suffisamment vite pour que Richard Smalley ait matière à défendre, en 1999, devant un sous-comité du Sénat, l'avenir des nanotechnologies. Ces technologies de l'infiniment petit dont il disait en écho au gourou de la discipline, Eric Drexler, qu'il allait "de l'intérêt supérieur de la nation" que les Etats-Unis "s'engagent avec audace dans ce domaine".
Une recommandation que se sont empressés de suivre les présidents Clinton et Bush avec la mise en place de la National Nanotechnology Initiative 2000, même si les fullerènes doivent encore faire la preuve industrielle de leurs qualités.