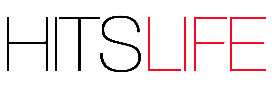Retour Rendus aux ruines de Katrina
Trois semaines après l'ouragan, 182 000 personnes ont pu regagner La Nouvelle-Orléans.
«Welcome home !» Voilà ce qu'on peut lire sur la feuille distribuée par les militaires à l'entrée de La Nouvelle-Orléans. Puis suit une série de recommandations : sur l'eau truffée de bactéries, les sols contaminés par le plomb, les câbles téléphoniques jonchant les rues. Des dizaines de milliers de voitures comme des épaves, des amoncellements d'ordures en putréfaction et, surtout, ces 160 000 maisons défoncées, à raser, sur fond d'hélicos tourbillonnant dans le ciel et de couvre-feu dès 6 heures du soir. Voilà le paysage que vont affronter les 182 000 personnes (sur quelque 485 000 avant l'ouragan Katrina du 29 août) autorisées, depuis ce week-end, à regagner leur domicile.
Evacué de force. Il y a Ed Edmiston, qui cherche la réponse à une énigme : qui est responsable de l'inondation de sa maison ? Ça l'agace, Ed, d'autant qu'il est flic chez les stups. «Je fais un métier sale, pas drôle, mais là, je reste interdit.» Il tourne autour de la propriété. Un joli lot, tout en bois exotique, construit en 1922 et estimé, avant Katrina, à «4,5 millions de dollars». Dont 15 000 dollars de ravalement englouti par les flots, et un rez-de-chaussée boueux et puant qu'il fait visiter. Ed habite dans le plus beau coin de Jefferson Parish, quartier chic de la ville, Audubon Boulevard, là où les palétuviers viennent lécher les toitures de demeures ancestrales. «Ces putains d'assureurs, vont nous niquer, comme d'hab !» La cinquantaine façon Clint Eastwood, Ed peut vous retracer l'histoire de sa ville depuis sa création. Il a l'oeil vif et les mots rares : «Fuck Bush ! Fuck ce trou-du-cul qui a sucré les crédits des digues pour nous plomber en Irak !»
Il y a Hubert Dixon, à vélo, qui invite chez lui, dans une zone pourtant interdite. Il y est resté quatre jours dans son lit, au plus fort du «déchaînement», dit-il. Sa maison est la seule du quartier à ne pas avoir été envahie par les flots, car elle est surélevée de un mètre. Autour, c'est la désolation : des meubles pendent du deuxième étage, des jouets trônent sur un toit, un chien, enfermé, hurle à la mort. Hubert n'aime pas les chiens. Il préfère raconter son histoire. Quatre jours après Katrina, il était entouré par les flots, la garde nationale est venue l'évacuer de force pour le conduire à l'aéroport. Il y est resté. Quinze jours. «J'aidais la Croix-Rouge, c'était un tel enfer, là-bas...» Samedi, on l'a laissé rentrer. Au loin, un incendie embrase une maison, une sirène retentit enfin. A deux pas, des militaires désoeuvrés font du lèche-vitrines. Mais Hubert est serein. «Grâce à Dieu.» Ah, Dieu... C'est grâce à Lui que notre homme, un Noir de 61 ans, a arrêté de fumer il y a vingt-cinq ans, de boire il y a treize ans. Grâce à Lui, qui a fait souffler les vents, sauter les digues, que «la ville a été enfin nettoyée de la drogue». D'accord, «Il a sacrifié 500 personnes», mais en «a sauvé tellement». Hubert va donc «prier pour que cela change». Et qu'on reconstruise tout, «en mieux». Sans que l'argent vienne tout gâcher. Il cite la Bible : «L'amour de l'argent est la règle d'or du diable.» Ce soir, Hubert dormira chez lui. Sans eau ni électricité. Mais avec quelques rations lancées par hélicoptère militaire.
Enorme flingue. Il y a Sean Traford, au coeur du quartier touristico-business, dans une allée sombre, derrière l'hôtel où il émarge. Peut-être est-ce à cause de l'odeur qui prend à la gorge qu'il engloutit bière sur bière. «Vous foutez quoi ici ?» menace-t-il d'abord, treillis militaire, main sur un énorme flingue, avant de proposer une mousse. Mister «J'ai-tiré-sur-les-pillards-qui-voulaient-me-tirer-ma caisse» se dit chatouilleux de la détente. «Je m'en suis fait deux, deux jours après Katrina. Blessés, seulement.» Ça doit être son passe-temps car, quand il ne se croit pas dans une «zone de guerre», Sean est, dans le civil, logisticien d'un hôtel du carré français : le Monteleone s'élève là, droit comme un i. «529 chambres, 431 employés, 65 millions de rénovation au printemps», énumère-t-il. Des palaces qui ont déjà rouvert abritent, pêle-mêle, policiers, militaires, FBI, Croix-Rouge, urgentistes, dont Sean se demande, non sans raisons, ce qu'ils «foutent encore là». «Qu'ils envoient plutôt des électriciens, des types des télécoms, des branleurs capables de nous brancher l'eau !» Pourtant, ceux-ci sont à pied d'oeuvre, avec des statistiques officielles de raccordement un peu gonflées. L'hôtel Monteleone, lui, reprendra son activité dans un mois. Au mieux. «Le maire se la pète en nous disant qu'il va rouvrir le quartier dès lundi, non ?» Peut-être un peu, c'est vrai.
Déprime. Il y a enfin Gerry Garwoord, immobile sur un fauteuil pliable. Lui aussi va rentrer chez lui : à Chicago. Pompier, le solide gaillard, 41 ans, a vu en quinze jours «des choses qu'[il] n'aurait jamais pensé voir». Enfin, «ici, en Amérique, dans un pays civilisé». D'abord, il a sauvé de la mort une vieille femme, emprisonnée cinq jours dans sa maison, «de l'eau jusqu'au cou». «On l'a sortie, vivante mais à moitié folle.» Puis il a éteint des incendies. Nettoyé quelques pâtés de maison. Depuis, il se sent las. «Voir des voitures enterrées sous la boue et des bateaux dans les arbres», et «découvrir encore des cadavres», mais plus sauver des vies. Gerry déprime, et ce n'est qu'un début, dit-il d'une voix douce. «J'y pense chaque nuit, ça me hante. Je vais y rêver longtemps, je crois.»
A deux pas, il y a les «locaux», les pompiers de La Nouvelle-Orléans. Muets. Sauf un, remonté : «Retour à la normale ? Vous plaisantez, j'espère !» Ses collègues, rincés, allongés dans leur camion, contemplent le vide. En face, des magasins éventrés, des chaussées défoncées, des ordures qui pendent aux chênes. En arrière-plan, les tours du quartier des affaires, écrasées par le soleil. Le tout dans un silence mortuaire. «On n'a pas servi à grand-chose, finalement, souffle Gerry. Moi, je l'ai vite compris. Eux, moins. Il va leur falloir du temps. Ici, on prend son temps et tout prend du temps.»