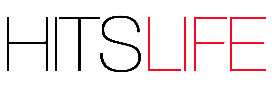Exposition Quand l'art cinétique faisait l'éloge du progrès
C'est l'histoire exemplaire d'un retournement de réputation. Pendant un quart de siècle, l'art optique et cinétique des années 1950 et 1960 a disparu des expositions. La surproduction de Vasarely, les dérives décoratives de plusieurs artistes et, plus simplement, l'ennui né de la répétition décourageaient la curiosité. Le premier indice d'un changement est apparu à Londres, quand, dans l'exposition conçue en 2002 par Sarah Wilson sur Paris, capitale des avant-gardes au XXe siècle, on a vu revenir Agam, Soto ou Schöffer. Aujourd'hui, le phénomène est plus net : une belle exposition dédiée à Nicolas Schöffer à Paris (Le Monde du 13 mai) et "L'Œil moteur" à Strasbourg, première rétrospective de ce mouvement dans son international ensemble.
Les réticences de Yaacov Agam
L'exposition de Strasbourg et son catalogue contiennent une rareté : une lettre ouverte de l'artiste Yaacov Agam dans laquelle il s'oppose à l'exposition "L'oeil moteur" . Il refuse de la "cautionner" "du fait de la confusion existant entre l'art cinétique tel qu'-il l'a- toujours conçu depuis sa fondation, c'est-à-dire s'exprimant au travers de la composante temporelle (la quatrième dimension), et l'art optique, totalement dépourvu de cette dernière" . A l'appui de son affirmation, Agam cite l'un des textes du catalogue, selon lequel il aurait le premier introduit dans l'art les notions de mobilité et d'imprévisibilité ce qui revient à tenir pour négligeable Marcel Duchamp en dépit de sa présence dans le parcours de l'exposition.
Tout en protestant contre un choix qui ne serait pas représentatif de son travail, Agam n'a pas souhaité retirer du parcours les oeuvres que les commissaires avaient empruntées, parmi lesquelles un très bel Assemblage mouvant de 1953 dont les six modules colorés peuvent pivoter.
[-] fermer
La réussite est certaine, dans le choix des oeuvres et dans la présentation, un modèle d'efficacité discrète. C'est plus la réussite d'une anthologie que d'une histoire. A une présentation narrative et chronologique a été préférée une succession de salles par sujet : le noir et blanc, la perturbation de la vision, le mouvement circulaire ou les expériences sonores. Ce mode de présentation rend manifeste la cohérence de l'art optique et cinétique dès l'introduction.
Celle-ci rassemble, sous le signe du noir et blanc, Bridget Riley, Victor Vasarely, son fils Jean-Pierre Yvaral et Jesus-Rafael Soto. Les principes sont fixés définitivement : des géométries abstraites parfaitement calculées, une exécution impeccable, une tendance à l'expansion dans l'espace que pousse à son extrême logique Riley en montant dès 1963 une architecture spiralée dont la paroi intérieure est peinte de chevrons et triangles noirs selon une progression dynamique qui accompagne la marche du visiteur. Il ne manque à ce Continuum qu'une bande-son pour qu'il réalise l'idéal d'un art total fondé sur des jeux et des rythmes visuels dans lesquels le spectateur s'absorberait jusque vers une forme d'hypnose.
L'un des traits les plus caractéristiques de cet art est en effet qu'il aspire à submerger les sens par tous les moyens. La surface du tableau ne lui suffit pas. Il prend possession de l'espace en superposant des écrans, en tendant des fils, en construisant des boîtes et des environnements que leurs miroirs rendent plus profonds qu'ils ne le sont réellement Agam, Soto, Megert, Malina. Il s'empare du temps en programmant des clignotements colorés, des éclairs, des mouvements de machines articulées Le Parc, Gerstner, Schöffer. Le moteur lui est aussi nécessaire que l'ampoule, et Schöffer intègre les inventions de ce qui s'appelle alors la cybernétique.
VIBRATIONS MAGNÉTIQUES
L'emploi du cinéma s'impose comme une évidence Sharits, Hill, Hains , et la sonorisation tout autant, éclat bruyant des martèlements métalliques de Vardanega ou légèreté des vibrations magnétiques selon Takis. Rares sont ceux qui s'en tiennent aux seules ressources de la peinture sur toile ou bois Morellet et Vasarely essentiellement ou de la construction non motorisée Arden Quin et ses remarquables Sculptures manipulables, l'une des surprises heureuses de l'exposition.
Laquelle en compte plusieurs autres : l'étrange Spazio elastico, de Colombo, qui soumet le visiteur à une expérience de déformation de l'espace obtenue avec des moyens matériels très simples, les sismographies lumineuses de Malina, la collection de lunettes et miroirs déformants de Le Parc, à mi-chemin entre abstraction géométrique et ironie dadaïste. Cette position ambiguë est plus encore celle du nouveau réaliste Raymond Hains, présent ici pour ses brouillages visuels obtenus grâce à des verres cannelés ou dépolis, et celle de Dieter Roth, dont les quadrillages typographiques de 1960 ne laissaient pas supposer quel artiste de la rébellion et de la répulsion il serait bientôt.
Ainsi se vérifie qu'à ses débuts le cinétisme a pu entretenir des connivences avec les autres mouvements expérimentaux de la fin des années 1950. Ils avaient en commun le dégoût de la peinture "lyrique" ou "informelle" façon Ecole de Paris, qui dominait alors le marché, et la conviction qu'elle était obsolète dans une société en mutation.
Les similitudes ne vont pas au-delà. Les nouveaux réalistes Tinguely, Spoerri ou Arman se méfient des machines, des productions en série, de la rationalisation industrielle et technique. Les cinétiques, eux, en raffolent. Leurs oeuvres avouent la fascination de leurs auteurs pour les programmes mathématiques, les systèmes de calcul, l'usinage au millimètre, le progrès à l'infini. Ils y croient, jusqu'à l'utopie et l'aveuglement. Ils veulent, avec des moyens ultramodernes, créer l'art d'un monde ultramoderne, en collaboration avec ses ingénieurs et ses moyens de communication. Etant donné ce que ce moderne est devenu et les innovations technologiques radicales intervenues depuis les années 1960, ces dispositifs optiques et dynamiques apparaissent aujourd'hui différemment : ils sont d'une autre époque, légèrement archaïque désormais, qui ignorait les puces et le virtuel. Ces objets qui célébraient le progrès par l'acier chromé, le vinyle et le Plexiglas ont le charme vieillot des DS Citroën et de l'ORTF en noir et blanc, celui de la France des "trente glorieuses" et des Mythologies de Roland Barthes.
UN CERTAIN ESPOIR
Ce n'est pas le moindre intérêt de l'exposition : on y voit combien l'art optique et cinétique est indissociable d'un certain état de la société et des idéologies, d'un certain espoir dans le nouveau qui s'était exprimé avec la même confiance dans le suprématisme de Malevitch, le néoplasticisme de Mondrian et l'enseignement du Bauhaus une quarantaine d'années plus tôt. En ce sens, cet art n'est pas une avant-garde, mais une néo-avant-garde. Celle-ci reprend de façon délibérée un langage plastique inventé par une génération antérieure, celle des grands-parents plutôt que celle des parents.
Ce langage lui convient parce qu'il s'agit pour elle de célébrer à son tour la modernité. Il n'est de meilleure allégorie de cette dernière que ces lignes d'ampoules des trois couleurs primaires et de leurs trois complémentaires qui s'allument et s'éteignent à intervalles réguliers, modifiables à volonté à l'aide d'un bouton et d'un programmateur. Cette pièce de 1965, invention de Karl Gerstner, s'appelle symboliquement Times Square.
Musée d'art moderne et contemporain, 1, place Hans-Jean-Arp, Strasbourg (Bas-Rhin). Tél. : 03-88-23-31-31. Du mardi au samedi de 11 heures à 19 heures, le jeudi de 12 heures à 22 heures, le dimanche de 10 heures à 18 heures. Jusqu'au 25 septembre. 5 €.