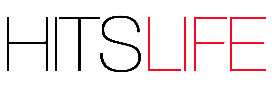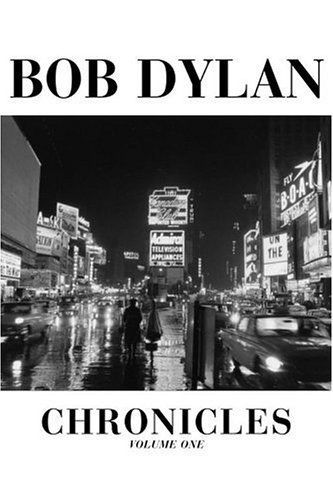Annonce “Chroniques» d'un Dylan anthologique
A 64 ans, le folksinger américain publie aujourd'hui en France le premier volume d'une autobiographie qui fait oeuvre de démystification.
«A ma place, n'importe qui serait devenu fou», écrit Bob Dylan à la page 128 du volume I de Chroniques (1), son autobiographie rédigée en «roue libre» (il s'agit d'un collage d'instantanés, succession de bonds spatio-temporels sans justification ni chronologie), en référence à un des disques qui a le plus contribué à établir sa notoriété : The Freewheelin' Bob Dylan. Et l'auteur, alors «coincé à Woodstock» (le patelin, pas le festival), «havre de paix source de pèlerinage pour tous les tapeurs et les tordus», d'argumenter avec véhémence : «J'avais une femme, des enfants, que j'aimais plus que tout, j'essayais de subvenir à leurs besoins, d'éviter les ennuis. Mais les ténors de la presse continuaient de faire de moi l'interprète, le porte-parole, voire la conscience d'une génération. Elle est bien bonne. Je n'avais fait que chanter des chansons nettes et sans détour, exprimant avec force des réalités nouvelles. Cette génération, je partageais fort peu de choses avec elle et je la connaissais encore moins.»
«Prenez-le, il est à vous !»
Chroniques, on l'aura compris, est une oeuvre de démystification. L'éclaircissement tardif (après quarante ans d'interprétations équivoques et fantaisistes) d'un douloureux malentendu. «Quelques années plus tôt, poursuit Dylan, Ronnie Gilbert, un membre des Weavers, m'avait présenté en ces termes à un festival folk à Newport : "Et le voici... Prenez-le, vous le connaissez, il est à vous !" Le mauvais augure m'avait échappé. On n'avait jamais annoncé Elvis de cette manière. Prenez-le, il est à vous ! C'est fou de dire un truc pareil ! Mon cul, oui. Pour autant que je sache, je n'ai jamais appartenu à personne, ni alors, ni maintenant.»
La preuve, ce livre, dont on était en droit d'attendre le pire dans le genre pensum indigeste ou divagations pseudo-poétiques à la Tarantula (roman de Bob Dylan), ne ressemble à aucun autre. Tout juste évoque-t-il (concision, sens du montage, maîtrise de l'écriture) le Moins qu'un chien, plus ou moins scandaleux, plus ou moins romancé, jadis publié par un autre fameux compositeur atypique, le contrebassiste pantagruélique Charles Mingus. Avec lequel Bob Dylan se serait à coup sûr bien entendu. Lui qui confesse un intérêt qu'on ne lui connaissait pas envers le jazz, de type be-bop (Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Charlie Parker, Miles Davis, Red Garland, Gil Evans, Roland Kirk...). Un après-midi, il se retrouvera même au Blue Note, seul et frêle en face du monumental Thelonious Monk, son clavier et son gros sandwich «qu'il ne finissait jamais» : «Je lui ai dit que je jouais de la musique folk un peu plus haut dans la rue. "On joue tous de la musique folk", m'a-t-il répondu», raconte Dylan.
«Une musique aseptisée et pasteurisée»
Hors le folk, donc, point de salut. Le folk dont Bob Dylan, lorsqu'il dresse un portrait du producteur John Hammond (l'homme qui, avant de le découvrir, signa, pour Columbia, Billie Holiday, Benny Goodman, Charlie Christian, Cab Calloway...), prétend qu'il était alors considéré comme «un genre mineur, médiocre, réservé aux seuls petits labels. Les gros, comme Columbia, produisant une musique aseptisée et pasteurisée, destinée celle-ci à l'élite». Pourtant, ironie du sort, alors que tous les labels spécialisés l'ont rejeté, c'est Columbia qui va le signer («John Hammond a posé un contrat devant moi, le contrat standard que j'ai signé sur-le-champ, sans entrer dans les détails pas besoin d'avocat, de conseiller, de qui que ce soit par-dessus mon épaule. J'aurais été content de signer le premier papier qu'on me tendait»), compagnie phonographique à laquelle il restera toujours fidèle. Ce qui, au passage, éclaire de façon significative la manière de fonctionner d'un personnage décidément moins complexe qu'on ne l'a cru.
Après être devenu «Bob Dylan», prétendu hobo (vagabond) arrivé du MidWest dans un train de marchandises (en fait, Robert, fils d'Abraham Zimmerman, comptable à Hibbins, Minnesota, avait débarqué à Manhattan dans une berline Chevrolet Impala quatre portes, modèle 1957), le jeune chanteur folk s'attache à construire sa légende, absorbant (encore et toujours) le meilleur de ce que ses multiples fréquentations peuvent lui apporter. Un peu à l'image du héros de Bronco Billy, le film de Clint Eastwood, qui, lui, est un ancien marchand de chaussures du New Jersey. Chroniques, en particulier dans sa première partie, est donc un précieux témoignage sur le New York des années 60. On y croise au fil des pages des personnages aussi emblématiques que Tiny Tim, l'hurluberlu à voix de falsetto et ukulélé ; Fred Neil, créateur d'Everybody's Talking ; Woody Allen et Richard Pryor, comiques débutants qui hantent les cabarets foireux ; Moondog, le poète viking du bitume ; Dave Van Ronk, le folkeux bancal et marxiste ; Richie Havens, le mancheur joliment accompagné ; Jack Dempsey, l'ancien champion du monde des poids lourds devenu restaurateur branché. Tous gens auxquels Bob Dylan est redevable de quelque chose.
On y découvre aussi des affinités peu évidentes, notamment celles qui lient l'auteur à Bobby Vee, idole des teenagers, à propos duquel il écrit : «Je n'ai jamais cessé de le considérer comme un frère.» Et on y apprend à l'occasion, non sans consternation, que parmi toutes les reprises de ses chansons, sa préférée est Positively 4 th Street revue par Johnny Rivers, «dont la pose et le phrasé mélodique parachevaient, voire dépassaient, le feeling que j'avais voulu y mettre». Bob Dylan aurait-il un goût déplorable en matière de musique ?
«On ressentait tellement la puissance de la littérature»
Ou peut-être celle-ci ne constitue-t-elle pas sa principale préoccupation artistique. «On ressentait tellement la puissance de la littérature, écrit-il en évoquant son arrivée à New York, qu'il fallait répudier son ignorance chérie.» Il ne va donc pas s'en priver. Voltaire, Rousseau, Gogol, Dickens, Tolstoï, Shelley, Maupassant, Balzac, Defoe, Pouchkine, Faulkner, Tennessee Williams, à l'en croire, ce type-là a tout ingurgité. De Tacite à Jules Verne, de Thucydide à Mickey Spillane. Et on veut bien le croire, car à la lecture de Chroniques, la question mérite d'être posée. Etiqueté éternel baladin polémiste, Bob Dylan ne serait-il pas plutôt un écrivain arrivé enfin à maturité ?
(1) Bob Dylan, Chroniques, volume I, traduit par Jean-Luc Piningre, Fayard. 320 pages, 20 euros.