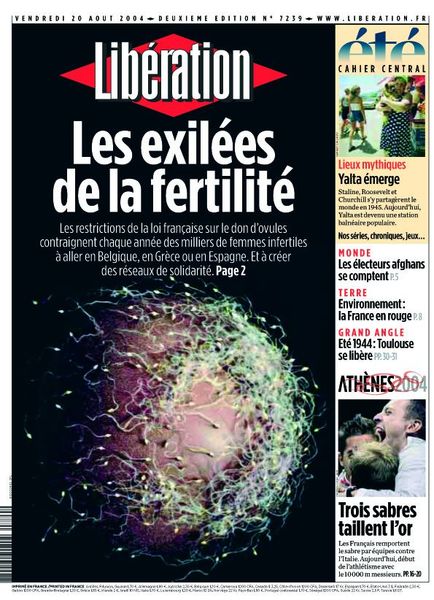Annonce Bioéthique
Ces femmes infertiles contraintes à l'exil
Face aux restrictions encadrant les dons d'ovules en France, des milliers de femmes se tournent chaque année vers la Belgique, l'Espagne ou la Grèce.
Ça leur est tombé sur la tête, brutalement. Une échographie sans appel pour Sahra, à 28 ans. Mais le plus souvent, des années d'examens et de traitement les ont préparées à ce verdict : elles ne pourront jamais faire de bébé toute seule. Leurs ovaires, ces glandes qui produisent les ovules et les hormones nécessaires à la fabrication d'un bébé, sont «défaillants».
Le désespoir dans lequel la plupart sombraient il y a peu encore a fait place à une énergie débordante. Ces femmes «défaillantes», décidées à tous prix à porter leur enfant, migrent par centaines chaque année dans des cliniques européennes pour recevoir les ovules d'une autre femme. Ils y sont fécondés in vitro avec le sperme de leur conjoint et réimplantés dans leur utérus. Le bébé ainsi conçu ne portera pas leur patrimoine génétique. Mais aux yeux de la loi française, il sera bien leur enfant : la mère est celle qui accouche.
Quelques centaines de milliers de femmes
On évalue à 10 % le nombre de couples confrontés à un problème d'infertilité porté par la femme (lire page 4), à 1 % le nombre de femmes soufrant d'une ménopause précoce avant l'âge de 40 ans (0,1 % avant 30 ans) : quelques centaines de milliers de femmes sont donc susceptibles d'avoir recours au don d'ovules. La France se montre pour elles très stricte, un rien cruelle. Contrairement à la Suisse, à l'Allemagne, ou à l'Italie, notre pays autorise les malchanceuses à bénéficier d'un don d'ovocytes. Mais dans un cadre législatif et médical tel que toutes, aujourd'hui, sauf les plus pauvres, se tournent vers la Belgique, l'Espagne et, depuis deux ans, la Grèce. Dans ces trois pays, les cliniques fleurissent, les femmes affluent, générant un business très lucratif qui n'a rien d'illégal mais reste totalement hors contrôle.
Les performances du système hexagonal d'AMP (Assistance médicale à la procréation) laissent songeur : en 2002, 170 couples ont eu accès à ce procédé qui a débouché sur... trente grossesses (1). Cela devrait légèrement s'améliorer dans les années à venir. Un décret du 24 juin lève l'obligation de congeler durant six mois les embryons issus du don d'ovules, principe de précaution sanitaire qui faisait chuter à 15 % le taux de réussite des transferts, quatre fois moins qu'avec un transfert d'embryons «frais». Mais le principal frein vient du manque de donneuses.
Selon la loi, elles doivent vivre en couple stable, être mères d'un enfant au moins, avoir l'accord de leur conjoint et se faire prélever leurs ovules anonymement et gratuitement. Il n'y a jamais eu en France de campagne publique d'incitation. Elles sont le plus souvent recrutées par une proche, puisqu'apporter une «donneuse» au pool permet de gagner un an ou deux. Elles doivent en outre avoir la foi chevillée au corps pour supporter le traitement hormonal, les prises de sang, la ponction, l'anesthésie générale mais surtout le mauvais accueil de beaucoup de centres français. La plupart des témoignages de donneuses que nous avons recueillis racontent une grande désorganisation, un manque de chaleur. «Je n'ai jamais eu le même interlocuteur, les infirmières étaient exaspérées par mes questions, chaque fois que je sortais de cet hôpital, je me sentais humiliée et j'avais envie de pleurer», accuse Corinne, mère de deux enfants.
Confidentielles il y a quelques années, les adresses à l'étranger circulent aujourd'hui chez tous les gynécologues et les centres officiels de l'AMP. Une gynécologue parisienne, attachée à un hôpital de l'Assistance publique, envoie directement ses patientes en Espagne et en Belgique: «Ici, il faut deux à trois ans d'attente - et encore, si elles apportent une donneuse -» Contrairement à la France, la Belgique, l'Espagne et la Grèce acceptent les femmes au-delà de 36 ans (2), jusqu'à 48-49 ans. A l'hôpital Erasme de Bruxelles, il faut compter 3 000 euros, plus 1 000 euros pour le traitement de la donneuse, un peu moins cher à la Simaf, à Vilvorde, où se pratiquent les dons directs. La Belgique est en perte de vitesse, sauf pour celles qui souhaitent un don interfamilial, car il faut «amener» une donneuse. L'ensemble du processus revient à 4 000 euros à la clinique Eugin de Barcelone, plus 1 000 euros pour le traitement de la donneuse, sans compter le déplacement et l'hébergement. Les tarifs de l'Angleterre (8 000 euros) et la mauvaise réputation des donneuses en font une destination peu prisée. L'engouement pour la Grèce, lui, date de moins de deux ans. Comme en Espagne, la loi permet d'y rémunérer les donneuses (5 000 euros), des étudiantes le plus souvent, et de faire de la publicité pour les recruter. Les prix pratiqués, 1 800 euros (en liquide selon plusieurs témoignages !) à la clinique Iakentro de Thessalonique, sont souvent l'argument décisif.
Pratiques à risque
Pour Hélène, recalée en France parce qu'elle était «trop vieille» - «ça fait plaisir d'entendre ça, à 38 ans, quand tu viens en plus d'apprendre que tu es ménopausée» -, la Belgique s'est imposée pour des raisons «éthiques» : «En Espagne et en Grèce, les donneuses sont rémunérées, elles sont très jeunes et pour la plupart n'ont jamais eu d'enfant. On manque de recul sur les conséquences pour leur fécondité de ces traitements hormonaux.» Le Dr Lehire, coprésidente du Gedo (Groupement d'étude du don d'ovocytes), en contact avec l'hôpital Erasme et la clinique Eugin, estime que ces établissements travaillent «tout à fait correctement». Eugin affiche un taux de grossesse de 50 %, 80 % au bout de quatre essais (soit 5 000 euros à chaque fois). Sensiblement comme Iakentro. «L'avantage de la Grèce, c'est que tu bloques tout en une semaine. On commence le traitement trois semaines avant (les prescriptions se font par mail, téléphone ou fax), la donneuse également, on débarque là-bas, ils recueillent le sperme de ton mec et font le transfert d'embryon juste avant le retour»» raconte Ana, mère de deux jumelles qui a réussi «du premier coup, à 45 ans». L'association Maia déplore les risques que prennent certaines candidates. «Pour multiplier les chances, les équipes grecques implantent quatre embryons. Et les femmes acceptent, elles ont subi tellement d'échecs. Résultat, nous avons de plus en plus de grossesses triples, avec des mères pas toutes jeunes.» Maia préfère aussi l'Espagne parce que, «contrairement à la Grèce, il y a une vraie transparence sur le profil des donneuses.»
Combien sont-elles ? Grâce aux informations et réseaux du net, on sait que le nombre de receveuses explose de mois en mois. L'association Maia envoie une quinzaine d'adhérents à l'étranger par mois. Eugin recevrait entre 500 et 1 000 Françaises chaque année. Les établissements grecs ne communiquent pas, «mais j'ai vu passer une bonne centaine de Françaises cette année rien que sur le forum que je fréquente», estime une internaute. La Belgique, elle, rassure les médecins français. «J'ai actuellement douze patientes en attente de transfert là-bas, dont deux qui ont choisi le don direct avec leur soeur», explique une gynécologue lyonnaise. Yolande en est à son deuxième échec en Espagne, deux grossesses gémellaires dont l'une s'est rapidement interrompue, l'autre à quatre mois. «J'ai fait le parcours complet en France» : des années de stimulation, deux opérations des ovaires, quatre FIV (fécondation in vitro)... «Il y a deux ans, j'ai appris mon exclusion par lettre recommandée de mon centre d'AMP. Humainement, ils m'ont détruite. Plus les années passaient plus ils me faisaient sentir que je ne valais pas la peine qu'on se donne tant de mal pour moi.» Elle repart en septembre à Barcelone pour un troisième essai.
Gynéco françaises hors la loi
Face à l'entêtement désespéré de leurs patientes, des gynécologues français se mettent parfois hors la loi. Valérie, qui n'avait plus les moyens de se payer une nouvelle tentative de transfert d'embryons en Belgique (après quatre échecs), est revenue en France avec ses embryons surnuméraires congelés, «mes petits Findus», planqués dans un conteneur plein d'azote, provenant d'un don de sa demi-soeur. Sa médecin les lui a réimplantés, pour le prix d'une consultation. Un bébé du premier coup. Aujourd'hui, elle se bat avec d'autres devant les tribunaux pour obtenir le remboursement de ses frais par la sécurité sociale, une de ses amies ayant obtenu 3 860 euros. Face à la Sécurité sociale qui leur a opposé deux refus au motif qu'elles auraient pu bénéficier des mêmes soins en France, des médecins leur ont fait des attestations militantes : «Nous aurions accepté avec plaisir madame X. dans notre centre d'AMP, mais étant donné le manque de donneuses, ce n'était pas possible.»