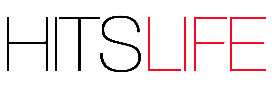Exposition A Paris, le Grand Palais expose des oeuvres japonaises des XVIIe et XVIIIe siècles, splendides évocations du corps et de ses plaisirs.
Esthètes estampes
Images du monde flottant,
Peintures et estampes japonaises XVIIe-XVIIIe siècles,
Galeries nationales du Grand Palais, 3, avenue du Général- Eisenhower, 75008. Jusqu'au 3 janvier.
e paravent offre à la peinture un support paradoxal. L'espace est à la fois unitaire et divisé, plat et plissé, délimité et potentiellement extensible. Toutes qualités auxquelles la reproduction photographique, qui aplatit ses volets en un tableau unique, ne fait pas honneur.
En revanche, au rez-de-chaussée du Grand Palais, où ils s'inscrivent en épis dans un univers vert (du plancher aux cimaises, scénographie plutôt réussie de Jean-Francois Bodin), les paravents japonais, pour la plupart du XVIIe siècle, envoient valdinguer toute tentative d'appréhension synthétique. La feuille d'or qui les couvre, parfois crêpelée d'un gaufrage de motifs, ou tachetée, ou griffée ou encore grattée, évoque à la fois la terre et les nuages, dans les replis desquels une forêt ou l'eau d'un lac sont vues à la fois de face et d'en haut. Comme le sont les tapis rouges où évoluent des cortèges de personnages, chacun fixé dans une posture différente (Anonyme, Divertissements à Higashiyama, époque d'Edo, XVIIe siècle, Kyoto).
Courtisanes. Ces paravents splendides, dont les volets multiples déroulent insatiablement diverses saynètes mouvementées poursuite de chiens, tir à l'arc, salons de musique, fumette, massages capillaires et autres attouchements plus indiscrets constituent les formes d'un art nouveau au Japon, l'art du divertissement. Du moins leur représentation : le spectacle des plaisirs comme une fête pour l'amateur ou le commanditaire.
En effet, les ukyo-e, appelées «images du monde flottant», ont pris leur essor à partir de la florissante époque d'Edo (si l'on veut, une sorte de Renaissance dans la capitale des shoguns, la future Tokyo). Dès le XVIIe siècle, bien avant Watteau en France et les fêtes galantes du XVIIIe, l'art s'intéresse savamment aux jeux de l'amour et du hasard, c'est-à-dire aussi au passage à l'éphémère et au transitoire.
«Dès qu'on sait que c'est un monde flottant, sans stabilité où que l'on aille, on a toujours le sentiment d'être en voyage» : un haïku du prince Kahuko, mort en 1153, sert d'exergue. Mais ce n'est pas un hasard si ces peintures de divertissement figurent à la fois les personnages qui jouent et ceux ou celles qui en jouissent. C'est aussi l'époque de l'individuation des personnages, qui commencent à acquérir des expressions singulières. Dans les maisons de plaisirs, figurées au XVIIIe siècle avec une scénographie rendue folle par la superposition d'une perspective à l'occidentale sur une stratification à l'orientale, les chalands vont commander et acquérir les portraits des courtisanes qu'ils ne peuvent pas se payer en chair et en os.
Kimonos. Encore faut-il s'entendre sur cette chair qui émeut l'amateur. Car il y a mille façons d'évoquer le corps indirectement. Beauté, de qui sont ces manches ? (XVIIe siècle, Kyoto) est un diptyque de paravents, deux fois six volets. D'un côté, un patchwork de kimonos pliés et suspendus à des présentoirs forme une composition décorative que ne renierait pas Matisse. De l'autre, des méandres d'encre et d'or bruni sont éclaboussés par la blancheur d'une flaque de fleurs, évoquant Edvard Munch ou Gauguin, puis tout le symbolisme européen. Ces images utilisent un système de correspondances, les fleurs renvoyant au parfum et donc à celle qui le porte ; de même que les vêtements repliés, se gonflant ainsi d'une charge sexuelle.
On découvre également la naissance du kabuki. Sur le paravent intitulé Kabuki d'Okumi (XVIIe siècle, Kyoto), figurerait le premier spectacle de danse en 1603, mené par Okumi, une femme, jouant un jeune samouraï. Dès 1629, les femmes sont frappées d'interdiction et les genres s'inverseront : des adolescents, puis des hommes mûrs, incarnent des rôles de femmes tout aussi prisés. Le «monde flottant» ne peut s'accompagner que d'un trouble de tous les genres.
Rose thé. Le second étage de l'exposition est moins stupéfiant. Il est entièrement dévolu à «Viens voir mes estampes japonaises», en l'occurrence le fonds pléthorique du musée Guimet, peu montré, avec les visages lunaires des courtisanes d'Utamaro, l'artiste vedette (1753-1806).
L'allusion au X est surlignée dans la scénographie toute de rose thé, qui retranche dans des cabinets rouges les planches intitulées Etreintes sous le Kotatsu, la Charette, Sous la moustiquaire, Rosée sur les chrysanthèmes, Concours de plaisir des 4 saisons, etc. Mais pour la commissaire Hélène Bayou, conservatrice à Guimet, les deux étages sont tenus par un même fil conducteur, celui de la figure et du plaisir, et de la figure paradoxale du corps dans l'art japonais, «qui n'est jamais nu, toujours déshabillé», explique-t-elle.
L'art japonais, aussi explicite (bite et con) soit-il, ne connaît ni l'anatomie, ni le modèle vivant, simplement la présence ou l'absence d'étoffes. Une hypothèse de plus pour comprendre la formidable attraction de cet art antinaturel aux yeux des modernes Européens, au tournant du XIXe au XXe siècle. Ceux-là, dégoûtés des «académies» et des modèles, affirmaient la primauté de l'affect.